Le mouvement ouvrier :
un mouvement pour le travail
« Le travail doit tout régenter,
Seul l’oisif sera esclave,
Le travail doit régenter le monde,
Car le monde n’existe que pour lui. »
Friedrich STAMPFER,
L’Honneur du travail, 1903
Le mouvement ouvrier classique, qui n’a connu son apogée que longtemps après le déclin des anciennes révoltes sociales, ne luttait plus contre le travail et ses scandaleuses exigences, mais développait presque une sur-identification avec ce qui paraissait inévitable. Il n’aspirait plus qu’à des « droits » et à des améliorations dans le cadre de la société de travail dont il avait déjà largement intériorisé les contraintes. Au lieu de critiquer radicalement la transformation de l’énergie humaine en argent en tant que fin en soi irrationnelle, il a lui-même adopté le « point de vue du travail » et a conçu la valorisation comme un fait positif.
Ainsi le mouvement ouvrier a-t-il hérité à sa façon de l’absolutisme, du protestantisme et des Lumières. Le malheur du travail s’est mué en fausse fierté du travail, qui redéfinit la domestication de l’individu en matériel humain de l’idole moderne pour en faire un « droit de l’homme ». Les ilotes domestiqués du travail ont inversé pour ainsi dire les rôles idéologiques et ont fait preuve d’un zèle de missionnaires, d’une part en exigeant le « droit au travail » et, d’autre part, en invoquant le « devoir de travail pour tous ». La bourgeoisie n’était pas combattue en tant que « fonctionnaire » de la société de travail, elle était au contraire traitée de « parasite » au nom même du travail. Tous les membres de la société, sans exception, devaient être enrôlés de force dans les « armées du travail ».
Le mouvement ouvrier est ainsi lui-même devenu un accélérateur de la société de travail capitaliste. Dans l’évolution du travail, c’est lui qui imposa, contre les « fonctionnaires » bourgeois bornés du XIXe et du début du XXe siècle, les dernières étapes de l’objectivation ; presque comme, un siècle plus tôt, la bourgeoisie avait pris la succession de l’absolutisme. La chose fut possible uniquement parce que, au cours de la déification du travail, les partis ouvriers et les syndicats se sont référés de façon positive à l’appareil d’Etat et aux institutions de l’administration répressive du travail qu’ils ne voulaient pas supprimer mais investir dans une sorte de « marche à travers les institutions ». Ainsi, ils poursuivirent, comme avant eux la bourgeoisie, la tradition bureaucratique de la gestion des hommes dans la société du travail telle qu’elle existait depuis l’absolutisme.
Mais l’idéologie d’une généralisation sociale du travail nécessitait également un nouveau rapport politique. Dans la société de travail qui ne s’était encore imposée qu’à moitié, il fallait remplacer l’ordre corporatiste et ses différents « droits » politiques (le droit de vote censitaire, par exemple) par l’égalité démocratique générale de l’ « Etat de travail » achevé. Par ailleurs, il fallait réguler, selon les préceptes de l’ « Etat social », les différences de régime dans le fonctionnement de la machine à valorisation, puisque celle-ci déterminait maintenant la totalité de la vie sociale. Là aussi, c’est au mouvement ouvrier qu’il revint d’en fournir le paradigme. Sous le nom de « social-démocratie », il devint le plus grand « mouvement citoyen » de l’histoire, mouvement qui ne pouvait cependant être qu’un piège tendu à celui-là même qui l’avait posé. Car, en démocratie, tout est matière à négociation, sauf les contraintes de la société de travail qui, elles, sont posées en tant que postulats. Ne sont discutables que les modalités et les formes de développement de ces contraintes. Nous n’avons de choix qu’entre Omo et Persil, la peste et le choléra, l’effronterie et la bêtise, Jospin et Chirac.
La démocratie de la société de travail est le système de domination le plus pervers de l’histoire : c’est un système d’auto-oppression. Voilà pourquoi cette démocratie n’organise jamais la libre détermination des membres de la société à propos des ressources communes, mais uniquement la forme juridique des monades du travail, socialement séparées les uns des autres, qui ont à rivaliser pour vendre leur peau sur le marché du travail. La démocratie est le contraire de la liberté. C’est ainsi que les hommes du travail démocratique se divisent nécessairement en administrateurs et administrés, en patrons et commandés, en élites de fonction et matériel humain. Les partis politiques, notamment les partis ouvriers, reflètent fidèlement ce rapport dans leur structure. Le fait qu’il y ait des chefs et des troupes, des personnalités et des militants, des clans et des godillots témoigne d’un rapport qui n’a rien à voir avec un débat ouvert et un processus de décision commune. Que les élites elles-mêmes ne puissent être que des fonctionnaires assujettis à l’idole Travail et à ses décrets aveugles fait partie intégrante de la logique de ce système.
Au plus tard depuis le nazisme, tous les partis sont devenus à la fois des partis ouvriers et des partis du capital. Dans les sociétés « en voie de développement » de l’Est et du Sud, le mouvement ouvrier s’est mué en parti-Etat chargé de réaliser, par la terreur, la modernisation tardive du pays ; à l’Ouest, en un système de « partis populaires » dotés de programmes interchangeables et de figures représentatives médiatiques. La lutte des classes est terminée parce que la société de travail l’est elle aussi. A mesure que le système dépérit, les classes se révèlent les catégories socio-fonctionnelles d’un système fétichiste commun. Quand la social-démocratie, les Verts et les anciens communistes se signalent dans la gestion de la crise en développant des programmes de répression abjects, ils montrent qu’ils sont les dignes héritiers d’un mouvement ouvrier qui n’a jamais voulu que le travail à tout prix.
Extrait du Manifeste contre le travail du groupe Krisis (co-écrit par Ernst Lohoff, Norbert Trenkle et Robert Kurz), paru en Allemagne en 1999 et traduit en français en 2002 (chez Lignes). Traduction établie par Olivier Galtier, Luc Mercier et Wolfgang Kukulies.
Bibliographie :
- L'intégralité du Manifeste contre le travail.
- Quelques bonnes raisons pour se libérer du travail, par Anselm Jappe
- Le travail est une catégorie capitaliste, par Anselm Jappe
- Avec Marx, contre le travail, par Anselm Jappe
- Travail fétiche, par Maria Wölflingseder
- Crise et critique de la société de travail, par Robert Kurz
- Travail forcé et éthos du travail, par Claus Peter Ortlieb
- Arbeit macht nicht frei. Libre commentaire des vues de Gunther Anders sur le travail, par Franz Schandl
- Les anarchistes ou l'impossible abolition de l'argent sans le dépassement du travail : Postface aux Fils de la nuit d'Antoine Gimenez (Giménologues)
- Annie Jacob, Le travail, reflet des cultures. Du sauvage indolent au travailleur productif, PUF, 1994.
- Pierre Bonte et Daniel Becquemont, Mythologie du travail. Le travail nommé, L'harmattan, 2004.
- Jean-Marie Vincent, Critique du travail. Le faire et l'agir, PUF, 1987.

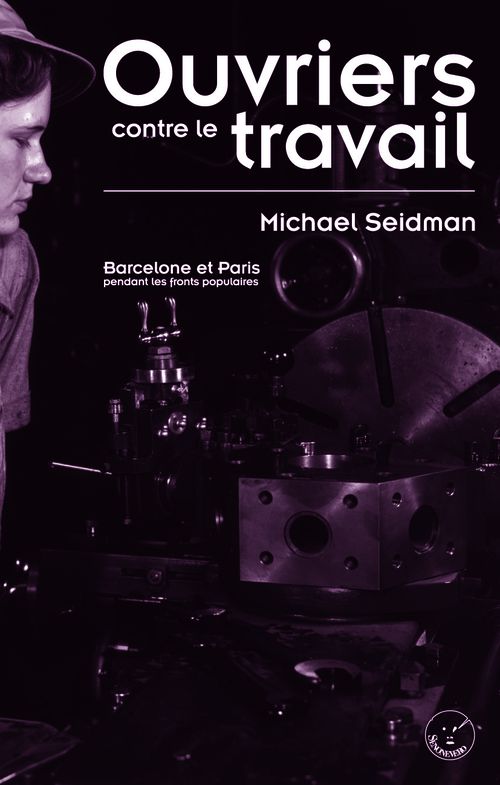


/image%2F1488848%2F20161113%2Fob_e27604_screen-shot-2011-11-08-at-22-20-58.png)
