
Les femmes des ruines de la crise
*
Robert Kurz
Le capitalisme a toujours été aussi une économie des rapports de genre. Les femmes sont fondamentalement rendues responsables des « moments dissociés de la vie » (Roswitha Scholz) par la société officielle. Ceci est vrai non seulement sur le plan socio-psychologique, dans le « travail relationnel et d'amour » (la femme en tant qu’être caressant), ou sur le plan symbolico-culturel, dans certaines attributions (la femme en tant que « nature »), mais aussi dans les activités matérielles, au sein et en dehors des ménages privés, qui sont importantes pour la reproduction, mais qui échappent à la logique de la valorisation du capital. Qu'il s'agisse de changer les couches des bébés, de cuisiner à la maison, de préparer le café au bureau ou de ranger après un séminaire, les femmes assument presque toujours seules ces tâches quel que soit le groupe. Plus de 90 % de l'éducation dans les familles monoparentales est assurée par des femmes.
Cette dissociation sexuelle s'observe dans tous les domaines de la société, et pas seulement dans la sphère privée. Dans l'économie officielle, les femmes sont, en règle générale, moins bien payées que les hommes, et si elles veulent grimper, elles doivent faire plus que les hommes. Il est également clair que les secteurs dans lesquels elles sont sureprésentées sont dévalorisés. Là où les femmes sont intégrées en masse au cours des dernières décennies, que ce soit dans le secteur public ou privé, elles ont été « doublement socialisées » (Regina Becker-Schmidt), c'est-à-dire que la dissociation des moments de la vie féminine est maintenue néanmoins sous la forme d'un double fardeau (enfants et carrière, objet de plaisir et femme qui a réussi).
Les illusions postmodernes incluaient l'espoir que de plus en plus de domaines de la reproduction quotidienne seraient socialisés, à travers des secteurs de l'État-providence ou de l'activité commerciale, en faveur d'une libération des possibilités féminines. Mais dans l'économie de crise depuis la fin des années 1990, l'État providence s'est retiré des secteurs des soins et de l'assistance (crèches, maisons de retraite pour personnes âgées, ateliers pour personnes ayant un handicap, etc.). Tout ce que l'État et le marché ne peuvent plus tenir, est à nouveau délégué à la partie féminine de la société. Les femmes doivent assurer le fonctionnement de l'économie souterraine non rémunérée, dans la famille, dans le quartier et dans d'autres secteurs, afin de maintenir une façade de normalité sociale bourgeoise.
Cette situation est particulièrement extrême dans les bidonvilles du tiers monde. Une fois de plus, ce sont les femmes qui, dans les projets sociaux autogérés et dans les organisations non gouvernementales (ONG), fournissent plus de 90 % des éléments fondamentaux de la reproduction sociale, de l'assainissement de base à l'organisation de l'éducation scolaire, avec l'aide d'organisations d'aide étrangères. Dans les favelas, on parle même ici et là d'une « nouvelle société matriarcale ». Cependant, le pouvoir réel est presque toujours entre les mains d'une pure mafia masculine armée, dont l'économie souterraine est basée sur la drogue, les armes et la prostitution. De son côté, l'État nourrit les ONG féminines avec de la charité et les revalorise moralement en retour. Tant la mafia que la gestion capitaliste des crises utilisent les femmes comme tampons de la crise et s'appuient sur leur activité sociale non rémunérée ou mal rémunérée.
Plus la crise progresse, moins la question du genre est prise en compte dans les mouvements sociaux, bien que les femmes soient de nouveau et de plus en exposées à la violence physique de la part d'hommes au statut précaire, tandis que les municipalités réduisent les subventions aux foyers pour femmes. Plus la situation est pénible, plus il y a de cas de plaintes de harcèlement dans les entreprises et les institutions, dont les femmes sont les principales victimes. Même dans les groupes théoriques de gauche, les femmes rebelles ayant des compétences plus que prouvées ont été « gentiment invitées à partir ».
Nous ne devrions pas être surpris si, dans un avenir proche, y compris dans la gauche, il y a un nouveau soulèvement de femmes qui ne veulent pas être transformées en femmes des ruines*, bon marché et moralement adulées, de la crise capitaliste.
Paru dans Neuen Deutschland, le 21 janvier 2005.
* Les femmes des ruines ou femmes des décombres (en allemand : die Trümmerfrauen, de Trümmer signifiant « décombres » et Frauen « femmes ») désignent les Allemandes et les Autrichiennes, la plupart veuves ou dont les maris sont absents (soldats prisonniers, disparus ou invalides), qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, reprennent les villes en main et entreprennent leur déblaiement et la reconstruction du pays (Note de la traduction).
Le côté obscur du capital. "Masculinité" et "féminité" comme piliers de la modernité (Johannes Vogele)
Remarques sur les notions de "valeur" et de "valeur-dissociation" (Roswitha Scholz)
La femme comme chienne de l'homme (Robert Kurz)
Splendeurs et misères des travailleurs modernes. Pour une critique de la masculinité moderne (Norbert Trenkle)
Marie, étend ton manteau. Production et reproduction à l'heure du capitalisme en crise (Roswitha Scholz)
Théorie de la dissociation sexuelle et théorie critique d'Adorno (Roswitha Scholz)
Le queer a fait son temps (entretien avec Roswitha Scholz)
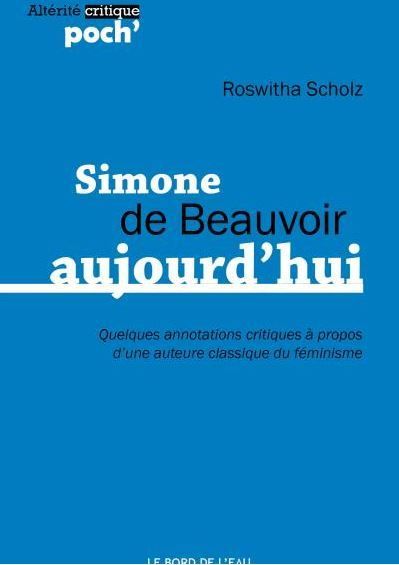
A paraître à l'automne 2019 aux éditions Crise & Critique (voir l'offre d'abonnement) :


/image%2F1488848%2F20161113%2Fob_e27604_screen-shot-2011-11-08-at-22-20-58.png)