Le dernier avatar de la classe moyenne
par Robert Kurz[1]
Voir le Fichier : Robert_Kurz-_Le_dernier_avatar_de_la_classe_moyenne-_20041.pdf
Depuis le milieu des années 1980, le paysage théorique mondial est dominé, en particulier à gauche, par le discours postmoderne. La critique de l’économie politique a cédé le pas à la critique du langage, et l’analyse des conditions matérielles objectives à l’arbitraire de l’interprétation subjective ; la gauche, en lieu et place de son traditionnel économisme, a adopté un culturalisme non moins réducteur ; enfin, les conflits sociaux se résument désormais à un simulacre médiatique. Dans le même temps, toutefois, la situation a changé du tout au tout. En Occident, la crise économique menace désormais de vastes couches sociales qui jusqu’ici avaient été épargnées. En conséquence, la question sociale effectue son grand retour dans le discours intellectuel.
Mais les interprétations demeurent étrangement vagues, sans force et presque anachroniques. La dichotomie riches/pauvres, si elle apparaît de plus en plus présente dans le discours, attend toujours d’être conceptualisée ; et le fait que la vieille notion marxiste de « classe » revienne au goût du jour est davantage un signe d’impuissance qu’autre chose. Selon l’interprétation traditionnelle, la « classe capitaliste » profite du fait qu’elle détient la « propriété privée des moyens de production » pour exploiter la « classe ouvrière » productrice de la survaleur. Or, aucun de ces concepts n’est pertinent face aux problèmes actuels.
En effet, la pauvreté aujourd’hui ne découle plus de l’exploitation dans le travail, mais de l’exclusion hors de la sphère du travail. Ceux qu’emploie encore la production capitaliste proprement dite font même figure de privilégiés. La société ne définit plus les masses « dangereuses » qui lui posent problème comme regroupant les individus en fonction de leur « position dans le procès de production », mais en fonction de celle qu’ils occupent dans les sphères secondaires et dérivées de la circulation et de la distribution. Ces masses comprennent chômeurs de longue durée et bénéficiaires de prestations sociales, mais aussi employés sous-payés du secteur des services externalisés, auto-entrepreneurs pauvres, vendeurs ambulants et autres chiffonniers. Du point de vue des normes en vigueur en matière de droit du travail, ces formes de reproduction s’avèrent de plus en plus entachées d’irrégularité, d’insécurité et souvent même d’illégalité ; en outre, l’embauche y est sporadique, et les maigres revenus qu’elles apportent frisent le minimum vital, quand ils ne tombent pas carrément en dessous.
A l’inverse, il n’existe plus non plus de « classe capitaliste » au vieux sens du terme, c’est-à-dire se définissant par la classique « propriété des moyens de production ». Que l’on considère l’appareil étatique avec ses infrastructures ou les grandes entreprises désormais transnationales, le capital semble être devenu d’une certaine façon socialisé et anonyme, et il n’est plus possible de mettre un visage sur la forme abstraite qu’il a revêtu. Aujourd’hui, « le capital » n’est pas une classe de propriétaires juridiques ; c’est le principe universel qui détermine la vie et les comportements de chacun des membres de la société, non seulement en tant que contrainte extérieure mais également jusque dans leur subjectivité même.
Au cours de la crise, et par le biais du processus de crise, s’accomplit une fois de plus une transformation structurelle de la société capitaliste dissolvant les vieilles strates sociales qui paraissaient claires. La crise prend sa source dans le fait que les forces productives nouvelles de la microélectronique ont fait se volatiliser le travail humain, c’est-à-dire la substance même du capital. A mesure que s’accélère la diminution du nombre de travailleurs dans l’industrie, la survaleur réelle est produite en quantités toujours moindres. Investir dans la création de nouveaux sites industriels n’étant plus rentable, les masses de capitaux se réfugient dans la sphère de la finance spéculative. Et tandis que des segments de population toujours plus importants sont éjectés hors de la production et réduits à la pauvreté, un simulacre d’accumulation capitaliste se poursuit via les bulles financières.
Ce processus n’a rien de nouveau : il façonne depuis plus de vingt ans le développement du capitalisme mondial. La nouveauté, en revanche, c’est que désormais les classes moyennes des pays occidentaux sont à leur tour menacées par le rouleau compresseur. L’essayiste américaine Barbara Ehrenreich avait évoqué dès 1989 la « peur de tomber » des classes moyennes[2]. Mais la question disparut ensuite – et durant une bonne décennie – derrière les chimères engendrées à la fois par la finance spéculative et par l’essor des NTIC et d’internet. L’effondrement de la Nouvelle Economie à partir de 2000 et l’éclatement en série de bulles financières qui secoua l’Asie, l’Europe et même, partiellement, les Etats-Unis, ont ravivé brutalement chez les classes moyennes la peur du déclassement.
*
Mais qui sont donc les « classes moyennes » et quel rôle social jouent-elles ? Au XIXe siècle déjà, le découpage des classes sociales n’était pas si évident. Entre les capitalistes possédant les moyens de production et les prolétaires ne possédant que leurs bras, venait s’insérer ce qu’on appelait la « petite bourgeoisie », catégorie ancienne dont les représentants étaient des propriétaires de petits moyens de production (boutiques, ateliers, etc.) qui produisaient généralement eux-mêmes, ou avec l’aide de membres de la famille, des produits vendus sur le marché. Les marxistes orthodoxes espéraient que ces « petits bourgeois » disparaîtraient peu à peu du fait de la concurrence des grandes entreprises capitalistes, et viendraient grossir les rangs du salariat industriel, de sorte que la société finirait par être entièrement polarisée autour des deux grandes classes antagonistes : la bourgeoisie et le prolétariat.
Cependant, au tournant du XXe siècle, la social-démocratie allemande fut le théâtre d’un débat célèbre entre Eduard Bernstein et Karl Kautsky[3] au sujet de la « nouvelle classe moyenne ». L’enjeu en était un certain nombre de fonctions techniques, économiques et intellectuelles ayant émergé au cours du déploiement de la société capitaliste. La rationalisation croissante de la production et l’expansion concomitante des infrastructures (administration, ingénierie, éducation et formation, santé, médias et communication publics, instituts de recherche, etc.) entraînèrent l’essor d’une catégorie « ni chair ni poisson » n’entrant plus dans les schémas traditionnels. On ne pouvait en effet définir ses membres comme des capitalistes : ils ne possédaient pas assez d’argent ; d’un autre côté, n’étant pas propriétaire de leurs moyens de production, n’ayant d’indépendance que formelle et restant largement tributaires du salariat, ils ne se rattachaient pas non plus à la petite bourgeoisie classique ; enfin, ils n’appartenaient pas davantage au prolétariat dans la mesure où ils n’étaient pas employés comme « producteurs directs » mais comme agents de l’expansion capitaliste des forces productives à travers toutes les sphères de l’existence.
Il y avait certes déjà des fonctionnaires au XIXe siècle, que l’on songe aux enseignants et autres agents de l’Etat ou à ces cadres d’entreprises que Marx a décrits comme une « hiérarchie complète de sous-officiers et d’officiers » du capital[4]. Cette catégorie sociale était cependant si peu nombreuse qu’on pouvait difficilement la qualifier de « classe ». C’est seulement plus tard, lorsque les exigences propres au capitalisme du XXe siècle réclamèrent massivement ces fonctions, qu’elle put constituer une nouvelle classe moyenne. Dans la polémique qui divisa les marxistes au début de cette évolution, Kautsky s’efforçait de faire entrer la nouvelle classe dans le schéma traditionnel et de la compter, d’une façon ou d’une autre, dans les rangs du prolétariat, tandis que Bernstein voyait dans ce phénomène social une stabilisation du capitalisme qui rendait envisageable un réformisme modéré.
D’abord, et pendant longtemps, il sembla que Bernstein avait vu juste. La nouvelle classe moyenne s’éloigna en effet de plus en plus de la classe ouvrière traditionnelle, non seulement de par le contenu et le lieu de son activité, mais également sur le plan économique. Barbara Ehrenreich retient pour critère d’appartenance à cette classe le fait que le « statut social [soit] basé sur l’éducation plutôt que sur la détention de capital ou d’autres avoirs ». Les qualifications supérieures obtenues par cette éducation particulièrement longue (parfois jusqu’à l’âge de trente ans ou plus) et dévorant des ressources considérables, accrurent la valeur de la force de travail bien plus fortement que les autres variations moyennes.
C’est dans ce contexte que naquit le terme lourd de conséquences de « capital humain ». Employés des secteurs de l’ingénierie, du marketing ou des ressources humaines, membres des professions libérales (médecins, avocats, etc.) et fonctionnaires (enseignants, chercheurs, travailleurs sociaux, etc.) « sont », d’une certain façon, doublement du capital. D’abord, leurs compétences leur confèrent le rôle stratégique d’encadrer et d’organiser le travail des autres à fins de valoriser le capital ; en outre, et particulièrement s’ils sont travailleurs indépendants ou cadres, ils ont tendance à considérer leur propre qualification, et donc leur propre personne, comme du « capital humain » : en bons capitalistes, ils s’efforcent de s’« auto-valoriser ». Le capital que détient la nouvelle classe moyenne ne consiste ni en numéraire ni en moyens de production, mais en aptitude à organiser le procès de valorisation à un haut degré de rationalisation scientifique et technologique.
Nombre de nouvelles fonctions du même genre firent leur apparition tout au long du XXe siècle, et les effectifs de la nouvelle classe moyenne augmentèrent en permanence. En particulier, le boom de l’après-Seconde Guerre mondiale, combiné à celui de l’industrie des loisirs et des nouvelles formes de production fordiste, impulsa un élan supplémentaire à cette évolution ; en témoigne le fait que, dans la plupart des pays, la proportion d’étudiants s’accrut sans cesse à chaque génération. Cependant, si le mouvement étudiant qui balaya le monde entier en 1968 établit définitivement l’importance croissante de ces catégories sociales, il constitua en même temps un premier symptôme de la crise. L’expansion de la classe moyenne avait jusqu’ici stabilisé le capitalisme exactement comme Bernstein l’avait prédit et amené des réformes graduelles, mais un processus de déstabilisation s’était désormais mis en branle.
Quoique le chômage massif et structurel engendré par la troisième révolution industrielle et par la mondialisation du capital parut d’abord affecter essentiellement la production industrielle, il devint bientôt évident que la nouvelle classe moyenne ne serait pas épargnée. A bien des égards, l’essor de cette classe avait été intimement lié à celui des infrastructures publiques, de l’éducation et de la bureaucratie propre à l’Etat-providence. Or, la crise de la valorisation frappant le secteur industriel enfonçait les budgets nationaux dans des difficultés financières de plus en plus graves. Partant, de nombreuses réalisations considérées jusqu’alors avec fierté, faisaient soudain figure de luxes inutiles et encombrants.
« Dégraisser l’Etat » devint le mot d’ordre ; on tailla dans les dépenses relatives à l’éducation, à la culture, à la santé et à nombre d’autres institutions publiques ; le démantèlement de l’Etat-providence avait commencé. Dans les grandes entreprises même, des pans entiers de main d’œuvre qualifiée furent victimes de la rationalisation des activités. Pour finir, le krach de la Nouvelle Economie acheva de dévaluer jusqu’aux compétences des spécialistes de la haute technologie. Aujourd’hui, on ne peut plus ignorer que l’essor de la nouvelle classe moyenne ne disposait d’aucune base capitaliste propre mais dépendait de la redistribution de la survaleur issue des secteurs industriels. A mesure que la production de survaleur sociale réelle entrait dans une crise structurelle du fait de la troisième révolution industrielle, un à un les secteurs secondaires de la nouvelle classe moyenne furent privés de leur terreau nourricier.
Il n’en résulte pas seulement un chômage en hausse chez les diplômés. En raison de la vague de privatisations et d’externalisations, ce sont aussi les qualifications de ce « capital humain » qui se voient dévaluées et leur statut qui se dégrade. Pigistes miséreux et autres professionnels « free-lance » des médias, des cabinets d’avocats ou encore des écoles et des cliniques privées, ne constituent plus des exceptions : désormais, ils sont la règle. Néanmoins, il se pourrait qu’en définitive Kautsky aussi se soit trompé. Car si la nouvelle classe moyenne « tombe » effectivement, elle n’en rejoint pas pour autant le prolétariat industriel traditionnel des producteurs directs, lequel ne représente plus qu’une minorité qui disparaît peu à peu. Paradoxalement, la « prolétarisation » des diplômés va de pair avec une « déprolétarisation » de la production.
Ainsi, la dévaluation des qualifications s’accompagne d’une extension objective du concept de « capital humain ». A contre-courant du déclin de la nouvelle classe moyenne, la société tout entière est le théâtre d’une sorte de « em(petit)bourgeoisement » inédit qui s’accélère avec la transformation des appareils industriels ou infrastructurels en gigantesques organisations anonymes. Les « moyens de production indépendants » rétrécissent jusqu’à rencontrer la peau des individus : chacun devient son propre « capital humain », qui n’est rien de plus que son corps nu. Il en résulte un contact direct entre l’individu atomisé et l’économie de la valeur, dont les déficits et les bulles financières entretiennent un simulacre de reproduction.
Plus grands sont les écarts de revenus entre riches et pauvres dans cette économie de bulles financières, et plus les différences structurelles entre les classes vont s’effacer au sein de la reproduction capitaliste. Il n’y a donc aucun sens à vouloir – comme le font un certain nombre d’idéologues de cette classe moyenne en déclin qui fut jadis nouvelle – reprendre à son compte une « lutte des classes du prolétariat » d’une époque révolue. Aujourd’hui, l’émancipation sociale exige de dépasser la forme sociale qui nous est commune à tous [5]. Le système de production marchande ne nous offre que des différences quantitatives de richesse abstraite, essentielles certes lorsque la survie est en jeu, mais stériles en termes d’émancipation. Un Bill Gates n’est ni plus ni moins « petit-bourgeois » que n’importe quel auto-entrepreneur pauvre : leur attitude envers le monde est identique et ils ont les mêmes mots d’ordre. Avec, aux lèvres, le vocabulaire du marché universel et de l’« auto-valorisation », ils franchissent ensemble les portes de la barbarie.
Traduction et notes : Sînziana
Quelques textes issus de Robert Kurz, Lire Marx (La balustrade, Paris, 2012) :
- Crise et critique de la société du travail (extrait de " Lire Marx ")
- Ils ne le savent pas mais ils le font : le mode de production capitaliste est une fin en soi irrationnelle (extrait de " Lire Marx ")
- Critique de la nation, de l'Etat, de la politique, du droit et de la démocatie (extrait de " Lire Marx ").
- Saignant et purulent par tous ses pores : le vilain capitalisme et sa barbarie. (extrait de " Lire Marx ")
- La véritable barrière du capital est le capital lui-même. Le mécanisme et la tendance historique des crises du capitalisme (extrait de " Lire Marx)
- Chasse autour du globe. La mondialisation et la fusionite du capital (extrait de " Lire Marx ")
- La mère de toutes les extravagances et la portée des jeunes loups de la Bourse : le capital porteur d'intérêts, la bulle de la spéculation et la crise de la monnaie (extrait de " Lire Marx " )
Quelques textes de Robert Kurz :
- Le vilain spéculateur (par Robert Kurz, 2003)
- Impérialisme de crise (2003)
- Même l'univers parallèle (internet) n'échappe pas à l'économie (2009).
- Le vilain spéculateur. (extrait de " Avis aux naufragés ", 2005)
- Populisme hystérique. Confusion des sentiments bourgeois et chasse aux boucs-émissaires (2001)
- Le dernier stade du capitalisme d'Etat (2008)
- Economie totalitaire et paranoïa de la terreur : sur le 11 septembre 2001.
- Non rentables, unissez-vous ! (2003)
- La femme comme chienne de l'homme (sur Sade, le genre et le capitalisme)
- L'honneur perdu du travail : le socialisme des producteurs comme impossibilité logique. (revue Conjonctures, 1997)
- Métamorphose du système-monde et crise de la critique sociale (extraits de " Les Habits neufs de l'Empire. Remarques sur Negri, Hardt et Rufin, Lignes, 2003)
- Manifeste contre le travail (Groupe allemand Krisis)

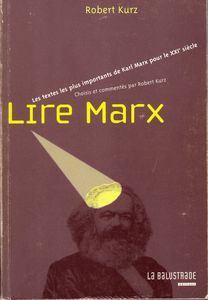
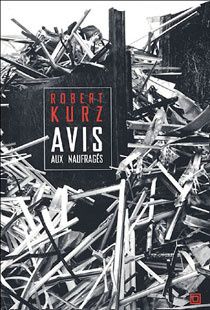


[1] Paru dans Folha de São Paulo, 2004 : http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=autoren&posnr=176.
[2] Barbara Ehrenreich, Fear of Falling: The Inner Life of the Middle Class, 1989.
[3] Eduard Bernstein (1850-1932), théoricien socialiste et militant du SPD, initia à partir des années 1890 un vaste mouvement de réinterprétation du marxisme, au cours duquel il rencontra l’opposition, entre autres, de Karl Kautsky (1854-1938), théoricien, secrétaire d’Engels et gardien du dogme.
[4] Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du parti communiste, 1848.
[5] Kurz pense ici à la forme de socialisation par le travail dans sa double nature concrète et abstraite, socialisation constitutive dans la seule société capitaliste d'une médiation sociale qui totalise à elle seule toute une société (formation sociale), la valeur qui se valorise (le capital comme sujet automate) au travers de la survaleur relative (note de Palim Psao).

/image%2F1488848%2F20161113%2Fob_e27604_screen-shot-2011-11-08-at-22-20-58.png)