
Ci-dessous une recension de l'ouvrage d'Ernst Lohoff et Norbert Trenkle, « La Grande dévalorisation. Pourquoi la spéculation et la dette d'Etat ne sont pas les causes de la crise » (Post-éditions, 2014).
Recension de « La grande dévalorisation », parue dans « Les Lettres françaises » n° 117 de juillet 2014
Il y a près de deux ans déjà, les « Lettres françaises » avaient rendu compte de la publication en Allemagne du livre de Ernst Lohoff et Norbert Trenkle en souhaitant vivement qu’un éditeur puisse rendre accessible cet ouvrage important à un public francophone. C’est chose faite grâce aux soins d’une toute jeune maison d’éditions, Post-éditions, et des trois traducteurs, Paul Braun, Gérard Briche et Vincent Roulet, qui se sont mobilisés autour d’un texte dense et exigeant. « La grande dévalorisation » est en effet une démonstration magistrale qui part du cœur en fusion du capitalisme pour expliquer les soubresauts récents de sa crise immanente. Les auteurs, tout en élaborant leurs propres développements indispensables et pénétrants sur le capital fictif, rappellent aussi que cette notion avait été posée dans ses principes fondamentaux par Marx, il y a déjà cent cinquante ans, à une époque où son rôle dans le procès capitaliste n’était qu’à un stade subalterne.
Lohoff et Trenkle participent depuis près de trente ans à une revue de théorie critique qui voit dans le concept de forme-marchandise le noyau le plus pertinent de l’œuvre de Marx. En effet, à partir de cette forme logique au cœur de la synthèse sociale capitaliste, on peut reconstituer tous les phénomènes qui s’y déploient dialectiquement, y compris les fausses consciences fétichistes qui renversent le sens des déterminations entre principes et apparences, et donc au-delà et en deçà de l’opposition « mécaniste » entre infrastructure et superstructure. Marx en avait fait l’exposé magistral dans le premier chapitre du « Capital », mais la tradition marxiste n’en a retenu qu’une interprétation positive là où il fallait y voir la critique de fausse évidence. Ainsi, travail, argent, État ne sont pas ces catégories allant de soi dont le sujet révolutionnaire devrait se contenter de dénoncer la spoliation et revendiquer la réappropriation, mais bien des fétiches aliénants en soi dont tout mouvement réellement émancipateur doit chercher l’abolition.
La forme-marchandise – qui n’est pas réductible à ses seules manifestations dans la sphère de la circulation, comme la propriété bourgeoise par exemple – implique par ailleurs un caractère dynamique qui permet de reconstituer une histoire du capitalisme qui ne soit pas simplement contingente ou, au contraire, purement déterministe, mais bien dialectique, comme cela est inscrit logiquement dans ce qui l’anime. Lohoff et Trenkle fournissent ainsi, dans une première partie, un panorama historique des transformations et reconstitutions du cadre capitaliste au cours du XXe siècle. On peut noter au passage qu’il y a là un usage de la dialectique qui s’appuie sur le déroulement logique des contradictions internes et non pas sur la fausse conscience de l’opposition entre des idéalités. Il n’y a donc rien à « reprendre » des phases antérieures du capitalisme qui n’auront été chacune que des aspects de la même aliénation mutilante ; tout reste à inventer.
Cependant, transformations et reconstitutions ne laissent pas intact le moteur contradictoire qui anime le capitalisme, c’est-à-dire la nécessité conjointe de consommer du travail humain immédiat comme source de la valeur et celle de le supprimer pour augmenter indéfiniment la productivité. A chaque nouvel obstacle que le capitalisme met lui-même sur sa route, un dépassement n’est temporairement possible qu’en constituant un potentiel de crise démultiplié. Trenkle et Lohoff montrent que la phase fordiste en crise s’est « résolue » dans l’avènement d’une industrie financière prenant le relais d’une valorisation du capital en panne dans l’économie réelle depuis les années 1970. Cette démonstration s’appuie sur l’introduction et le développement dans les deuxième et troisième parties d’une innovation conceptuelle qui prolonge les réflexions de Marx sur le capital fictif. En effet, pour mieux saisir le rôle et les effets de ce capital fictif, Trenkle et Lohoff le caractérisent comme marchandise d’ordre 2 : sa production engendre un dédoublement de valeur, comme un reflet, avec cependant des effets bien réels qui ont eux-mêmes des échéances et sont donc limités dans le temps.
Depuis bientôt quarante ans, le capitalisme est un mort vivant, un zombie dont la marche forcenée ne se maintient ainsi que par l’accumulation de paris sur le futur. Le capital ne se valorise plus en consommant le travail passé, mais sur des promesses de plus en plus illusoires de travail à venir. Aucun retour à l’économie réelle n’est par ailleurs envisageable : le niveau de productivité, atteint notamment par l’introduction des techniques numériques, ne permet plus d’envisager d’investissement rentable pour des capitaux démesurément gonflés. Pourtant, c’est bien ce gonflement qui assure, comme effet secondaire, que l’activité irrationnelle de nos sociétés ne s’interrompt pas tout simplement faute de carburant dans le moteur capitaliste.
Si la base misérable que représente la production actuelle pour la valorisation du capital ne donne déjà plus aucune perspective pour le fonctionnement propre de l’économie réelle, la base de plus en plus restreinte de porteurs d’espoirs qui alimente la production de capital fictif a aussi commencé à montrer explicitement ses limites avec la crise de 2008. La valeur jusque là accumulée et qui s’est avérée inopérante par ses propres moyens, s’est alors retrouvée parquée dans la dette publique et les titres détenus par les banques centrales émettrices de la monnaie. Les États et les institutions monétaires sont devenus les garants en dernier ressort – et cette fois-ci bien concrètement, pas seulement dans les discours – du fonctionnement d’une mécanique obsolète. Le titre de l’ouvrage, « La grande dévalorisation », fait référence à l’issue de cette (ultime ?) phase du capitalisme, à la fois en tant que conséquence, mais aussi comme porte de sortie potentielle en annihilant les fétiches sur lesquels repose son auto-mouvement.
Éric Arrivé
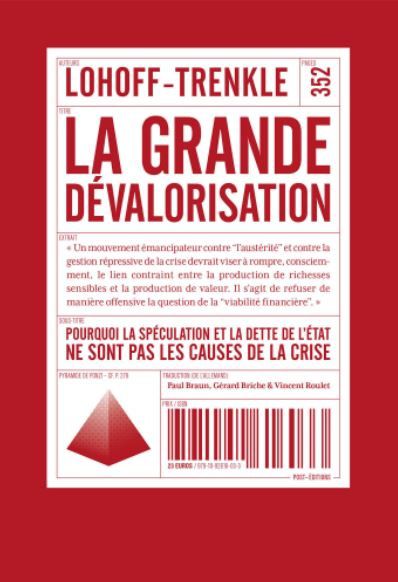

/image%2F1488848%2F20161113%2Fob_e27604_screen-shot-2011-11-08-at-22-20-58.png)