Anselm Jappe Crédit à mort Lignes, 254 pp., 20 €.
Anselm Jappe est le représentant français d’une école de pensée relativement confidentielle, mais qui pourrait gagner de l’audience à la faveur de la crise du capitalisme financier: l’école de «la critique de la valeur», pouvant tout aussi bien s’appeler «la critique du fétichisme de la marchandise» ou «la critique du travail». Née au milieu des années 80 autour de la revue Krisis, nourrie de Marx, de l’Ecole de Francfort et de Debord, la «critique de la valeur» se distingue du marxisme classique, en mettant l’accent non sur la distribution inégale des richesses produites, mais sur le mécanisme même de production des richesses. Pour elle, le capitalisme transforme tout objet en «fétiche» et toute activité humaine en «travail abstrait». Le capitalisme, c’est le régime dans lequel «l’activité productrice et les produits ne servent pas à satisfaire des besoins, mais à alimenter le cycle incessant du travail qui valorise le capital et du capital qui emploie du travail».
Productivité. Une théorie se fortifie au contact de la réalité et si le livre d’Anselm Jappe est précieux, c’est qu’il permet de mesurer le pouvoir explicatif de la «théorie de la valeur» appliquée à divers sujets, de la vie politique française à l’art contemporain. Le plus frappant est le chapitre central où il analyse la crise des subprimes (et qui donne son titre à l’ouvrage : Crédit à mort). Jappe y rappelle le paradoxe fondateur du capitalisme tel que Marx l’avait déjà formulé : si c’est en exploitant le travail humain que le capital réalise des profits, chaque gain de productivité rendu possible par l’automatisation et la technologie a pour effet de réduire la part humaine dans le bien produit. «La valeur de chaque marchandise singulière contient donc des parts toujours plus minces de travail humain - qui est cependant sa seule source de survaleur, et donc de profit.»
Relais. Pendant cent cinquante ans, l’extension de la production des marchandises à l’échelle mondiale a pu compenser cette tendance, avant de toucher ses limites à partir des années 60. Certes, la production des biens a poursuivi depuis son accroissement, mais non la production de la valeur, qui est le seul objet du capitalisme. Pour Jappe, c’est le développement faramineux du crédit, né de l’abandon de la convertibilité du dollar en or en 1971, qui a permis de trouver un relais. Car qu’est-ce que le crédit, sinon «un profit consommé avant d’avoir été réalisé»? Si le néolibéralisme se définit avant tout comme la possibilité de gonfler sans limite l’endettement des entreprises, des Etats et des particuliers, via des instruments financiers de plus en plus sophistiqués, son avènement à l’aube des années 80 ne serait nullement «une sale manœuvre des capitalistes les plus avides, un coup d’Etat monté avec la complicité de politiciens complaisants, comme veut le croire la gauche "radicale"», mais bien «la seule manière possible de prolonger encore un peu le système capitaliste». La fameuse «création de valeur» dont se rengorgent les PDG devant leurs actionnaires, ne serait qu’une gigantesque bulle, prête à éclater.
Les analyses de Jappe, parfois rapides, sont rythmées d’observations d’ordre moral plus que politique. Se demandant pourquoi il est si difficile d’imaginer la fin du capitalisme, il note : «L’idée même suscite une peur bleue. Tout le monde pense avoir trop peu d’argent, mais chacun se sent menacé dans son existence, même sur le plan psychique, si l’argent fait mine de se dévaloriser et de perdre son rôle dans la vie sociale. […] Il y a un accord général au moins sur une chose : il faut continuer à vendre, à se vendre, et à acheter. […] Il faudrait combattre le sujet automate du capital, qui habite également dans chacun de nous, et donc une partie de nos habitudes, goûts, paresses, inclinations, narcissismes, vanités, égoïsmes… Personne ne veut regarder le monstre en face.» A propos des gens inquiets de perdre leur travail, il estime, à rebours de la gauche, que leur colère «n’a rien d’émancipateur en tant que tel». Analysant l’art contemporain, il formule l’hypothèse que «l’équivalent du fétichisme dans la marchandise dans la vie psychique est le narcissisme».
Mise en garde. Né en 1962, d’origine allemande mais vivant entre l’Italie et la France, auteur des Aventures de la marchandise et d’un ouvrage remarqué sur Guy Debord, Anselm Jappe égratigne à plusieurs reprises les théoriciens les plus connus de la gauche radicale. Negri, Badiou, Zizek ou l’Insurrection qui vient en prennent chacun à leur tour pour leur grade et le chapitre consacré à la violence politique est une mise en garde sans détour à Julien Coupat et ses amis : «si la guerre civile - la vraie - éclatait, il ne serait pas difficile d’imaginer qui seraient les premiers à se trouver réveillés en pleine nuit et collés au mur sans façon, tandis qu’on viole les femmes et qu’on tire sur les enfants…» Jappe préfère pointer ses accords (et ses désaccords) avec des pensées moins extrémistes, comme l’anti-utilitarisme d’Alain Caillé, le «décroissantisme» ou, plus inattendues, les thèses de Jean-Claude Michéa sur la gauche culturelle devenue l’idiot utile du libéralisme. C’est que, sous la plume de Jappe, la théorie de la valeur marie véhémence anticapitaliste et accablement nostalgique devant la culture contemporaine. Ainsi, au détour d’une phrase, affirme-t-il qu’aujourd’hui «les seules propositions "réalistes" - dans le sens où elles pourraient effectivement infléchir le cours des choses - sont du genre : abolir tout de suite, dès demain, toute la télévision.»
Bibliographie française sur la " Critique de la valeur " :


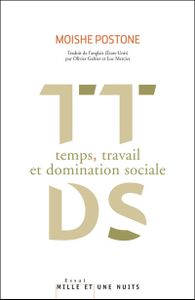



/image%2F1488848%2F20161113%2Fob_e27604_screen-shot-2011-11-08-at-22-20-58.png)
