Cet été, nous conseillons tout particulièrement la lecture des livres suivants :

Qu'est-ce que le travail ? Pourquoi travaillons-nous ? Depuis des temps immémoriaux, les réponses à ces questions, au sein de la gauche comme de la droite, ont été que le travail est à la fois une nécessité naturelle et, l'exploitation en moins, un bien social. On peut critiquer la manière dont il est géré, comment il est indemnisé et qui en profite le plus, mais jamais le travail lui-même, jamais le travail en tant que tel. Dans ce livre, Hemmens cherche à remettre en cause ces idées reçues. En s’appuyant sur le courant de la critique de la valeur issu de la théorie critique marxienne, l'auteur démontre que le capitalisme et sa crise finale ne peuvent être correctement compris que sous l’angle du caractère historiquement spécifique et socialement destructeur du travail. C'est dans ce contexte qu'il se livre à une analyse critique détaillée de la riche histoire des penseurs français qui, au cours des deux derniers siècles, ont contesté frontalement la forme travail : du socialiste utopique Charles Fourier (1772-1837), qui a appelé à l'abolition de la séparation entre le travail et le jeu, au gendre rétif de Marx, Paul Lafargue (1842-1911), qui a appelé au droit à la paresse (1880) ; du père du surréalisme, André Breton (1896-1966), qui réclame une « guerre contre le travail », à bien sûr, Guy Debord (1931-1994), auteur du fameux graffiti, « Ne travaillez jamais ». Ce livre sera un point de référence crucial pour les débats contemporains sur le travail et ses origines.
Alastair Hemmens est un auteur, chercheur et traducteur, qui vit à Cardiff, au pays de Galles.
Editions Crise & Critique, 2019.

Il n'est pas besoin d'être un « anti-système » féroce pour faire admettre à presque chacun que le monde va très mal. Il suffit de lire un journal bourgeois de qualité moyenne pour s'en convaincre chaque jour. Et, de ce point de vue, il ne serait donc pas nécessaire de fonder une nouvelle revue pour diffuser la mauvaise nouvelle.
En revanche, quant à identifier les causes des malheurs en cours, c'est tout autre chose ! Le sujet contemporain se trouve face à une myriade de tentatives d'explication, dont le point commun principal est de ne pas avoir de point commun et de se fragmenter dans une mer d'explications partielles.
Ce qui manque, et qui manque cruellement, c'est la théorie, des efforts cohérents pour comprendre la réalité à travers une théorie. Dans une société habituée depuis longtemps à l'acceptation passive de tous, où les seules forces organisées sont celles qui veulent la poursuite du capitalisme et du spectacle, il est évident que ce que nous devons accomplir aujourd'hui est la critique impitoyable de tout ce qui existe.
Jaggernaut est à l’origine le nom du char processionnel de la déesse hindoue Vichnou. « Le culte de Jaggernaut », écrit Marx, « comprenait un rituel très pompeux et donnait lieu à un déchaînement du fanatisme qui se manifestait par des suicides et des mutilations volontaires. Les jours de grandes fêtes religieuses, des fidèles se jetaient sous les roues du char portant la statue de Vichnou-Jaggernaut ». Une métaphore, que Marx va employer à plusieurs reprises en parlant des êtres humains jetés « sous les roues du Jaggernaut capitaliste », afin de pointer la dimension sacrificielle, fétichiste et destructrice du capitalisme.
Se voulant une passerelle entre les mondes germanophone, lusophone et francophone, Jaggernaut constitue la première revue en langue française liée aux courants internationaux de la « critique de la valeur » et de la « critique de la valeur-dissociation ». Inspirée par Marx mais sans s'y limiter, la critique de la valeur-dissociation procède d'une critique radicale du travail et de l'argent, de la marchandise et de la valeur marchande, de l'Etat et du patriarcat, du sujet moderne et des idéologies de crise.
Editions Crise & Critique, 2019.

En s'appuyant sur les thèses de Debord, Marx et Lukacs, l'auteur fait une lecture contemporaine du capitalisme actuel. Ce livre part d'observations sur la publicité, le cinéma, la littérature de masse ou les réseaux sociaux, etc.. Chaque analyse renvoie à une réflexion sur le travail, le salariat ou la valeur. Tout est lié par la marchandisation abusive de tout et de tous. Il ne peut plus y avoir ni compréhension du monde, ni lutte, ni projet social qui ne soient globalisés, à la mesure de la puissance capitaliste. L'auteur propose une réflexion sur les luttes possibles. Ce livre nous est indispensable contre la mystification, l'aliénation et la marchandisation généralisée.
Editions L'Harmattan, 2019.
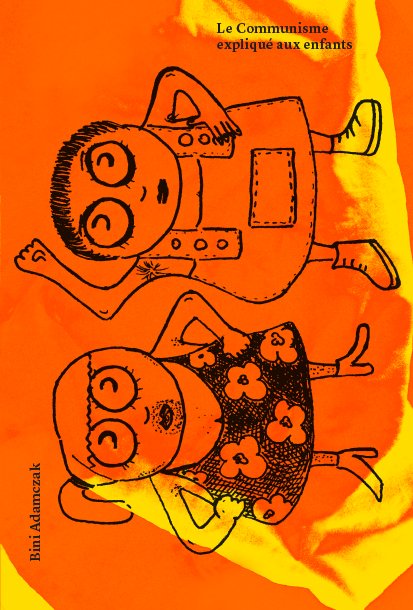
Traduit depuis l’allemand
Il était une fois des personnes qui aspiraient à se libérer de la misère du capitalisme. Comment faire pour que leur désir de changement puisse devenir réalité ? Ce petit livre propose une vision différente du communisme, fidèle à son ambition : se débarrasser d’un monde de souffrance et d’oppression. Mobilisant les ressources de la littérature enfantine, mais pas seulement, ce texte cherche à rendre abordable pour toutes et tous certains concepts de la théorie marxiste et communiste. Princesses et usines, paysannes et travailleuses opprimées, deviennent les actrices d’un récit ludique et illustré par lequel il s’agit de revenir sur l’histoire du capitalisme, sur celle de la féodalité, sur la théorie des crises, sur les formes multiples de la domination et de l’exploitation, mais aussi et surtout sur les différentes définitions et compréhensions de la visée communiste.
Bini Adamczak est une théoricienne et artiste basée à Berlin. Ses recherches et écrits portent sur la théorie sociale critique, les politiques queers, ainsi que sur l’historicité des révolutions. On lui doit notamment une étude publiée en 2017 chez Suhrkamp à propos de liens entre la séquence politico-sociale de 1917 et celle de 1968 (Beziehungsweise Revolution. 1917, 1968 und kommende), ou encore une autre plus précisément consacrée à l’histoire du communisme depuis la Révolution d’Octobre (Gestern Morgen).
Editions Entremonde, 2018

« Jusqu’à quel point le mouvement révolutionnaire fut il responsable de sa propre défaite ? » demandait Vernon Richards en 1953.
Dans l’Espagne de 1936, que restait-il du projet communiste libertaire après le 19 juillet quand en le propulsant en Catalogne, en Aragon et en pays valencien, un certain nombre de militants de la CNT-FAI se rendirent compte qu’ils agissaient à contre-courant de leur organisation ? Comment parler encore de sortie du capitalisme quand un syndicat anarcho-syndicaliste « collectivise » le secteur productif sous l’égide de l’Etat, incite la classe ouvrière à s’adapter « au panorama économico-industriel du monde », et repousse aux calendes grecques l’abolition du salariat ?
Premier volume : Et l’anarchisme devint espagnol
Second volume : L’anarcho-syndicalisme travaillé par ses prétentions anticapitalistes 1910-1937
Editions Divergences, 2019.
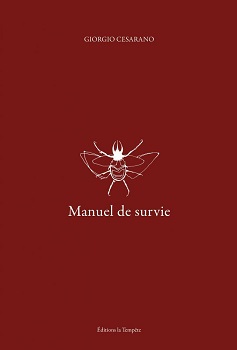
Écrit en 1974, près d’un an avant la disparition tragique de son auteur, le Manuel de survie est l’œuvre dans laquelle l’aventure humaine et théorique de Giorgio Cesarano trouve son expression la plus aboutie. Dès les années 1970, Cesarano observe que le développement du capitalisme sur l’intégralité de la planète exige de penser à nouveaux frais. Le monde comme les subjectivités sont désormais devenus fictifs. Les termes du conflit sont redistribués. Non plus « socialisme ou barbarie », mais « communisme ou destruction de l’espèce humaine. » Loin d’invoquer les formes historiques de la révolution, Cesarano propose d’un même mouvement une analyse profonde des développements du capital et une critique radicale des subjectivités contemporaines. A la survie organisée il oppose une vraie gnose indissociablement liée à la vraie guerre : « l’insurrection érotique », c’est-à-dire une prise d’arme contre la mort quotidienne, un minutieux sabotage de la « personne sociale » et, enfin, la réalisation de la communauté humaine.
Editions La Tempête, 2019.

Voir la traduction française de l'éditorial[1]
Du n°16 de la revue Exit !, mai 2019
Thomas Meyer

Schmetterling Verlag GmbH (1 de octubre de 2019)

/image%2F1488848%2F20161113%2Fob_e27604_screen-shot-2011-11-08-at-22-20-58.png)